Briser le cercle vicieux du syndrome de l'imposteur
- Anne-laure Renard
- 7 sept.
- 3 min de lecture

Le syndrome de l’imposteur est bien plus qu’un simple manque de confiance en soi. C’est la croyance persistante d’être un imposteur — convaincu que ses réussites sont dues à la chance et que son incompétence sera tôt ou tard révélée.
Cet état d’esprit est étroitement lié à l’anxiété, à la dépression et au burn-out. Il nuit à la réussite professionnelle en réduisant les performances, en freinant les ambitions et en poussant à refuser des opportunités. Au-delà du travail, il fragilise le bien-être, mine la résilience et alimente la honte, le doute de soi, la solitude et l’épuisement. L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en souffre également.
Qui est concerné ?
Les études montrent que la plupart des personnes connaissent le syndrome de l’imposteur à un moment de leur vie. Il est particulièrement fréquent chez les personnes à haut potentiel et chez celles qui se sentent « différentes » de la majorité de leurs collègues — en raison de leur genre, de leur origine ethnique ou de leur parcours socio-économique. Des recherches indiquent que 70 % des hauts performants en font l’expérience.
Ce phénomène est nourri par la comparaison malsaine avec les autres, le perfectionnisme (se mesurer à un idéal inatteignable) et la peur de l’échec. Beaucoup masquent ce sentiment derrière une façade de confiance, ce qui les isole et les empêche de réaliser que d’autres traversent la même épreuve.
Que peuvent faire les organisations ?
Les dirigeants et les entreprises jouent un rôle clé dans la réduction du syndrome de l’imposteur en créant des environnements plus favorables :
Favoriser la collaboration plutôt que la compétition : éviter les exigences irréalistes, les délais intenables et les cultures de rivalité.
Soutenir les managers : leur fournir une formation adaptée, les encourager à modéliser l’empathie et à donner des retours constructifs.
Promouvoir le mentorat et le soutien entre pairs : développer des réseaux où les employés peuvent apprendre, partager et normaliser les difficultés.
En parler ouvertement : reconnaître l’existence du syndrome de l’imposteur dans l’entreprise pour briser le silence et l’isolement.
Que peut-on faire ?
À un niveau personnel, plusieurs stratégies peuvent aider à gérer et à surmonter le syndrome de l’imposteur :
Se rappeler que l’on n’est pas seul : des personnalités comme Maya Angelou, Neil Armstrong, Tom Hanks, Jodie Foster ou Meryl Streep en ont témoigné publiquement.
Briser le silence : en parler permet de réduire la honte et la solitude.
Remettre en question les schémas de pensée négatifs : recadrer les croyances comme « j’ai réussi par chance », éviter le catastrophisme et la généralisation excessive.
Distinguer faits et émotions : une émotion forte ne reflète pas nécessairement la réalité.
Fixer des objectifs réalistes : remplacer le perfectionnisme par des standards atteignables.
Tenir un journal de ses réussites : un outil concret pour contrer le doute de soi.
Accepter les retours positifs : apprendre à les accueillir plutôt qu’à les minimiser.
Pratiquer l’autoréflexion : écrire aide à clarifier les pensées et à observer ses progrès.
Envisager une thérapie : un accompagnement professionnel peut aider à identifier les racines profondes et à développer des stratégies adaptées.
Aller de l’avant
Le syndrome de l’imposteur est répandu, mais il ne doit pas définir votre parcours. En construisant des cultures de travail plus inclusives et en adoptant des pratiques personnelles plus saines, son impact peut être réduit.
En partageant nos expériences, en nous soutenant mutuellement et en déconstruisant les croyances limitantes, nous pouvons transformer ce syndrome d’un fardeau individuel en une opportunité collective de croissance.
Sources:
Bagheri Sheykhangafshe, F., Tajbakhsh, K., Savabi Niri, V., Mikelani, N., Eghbali, F., & Fathi-Ashtiani, A. (2022). The effectiveness of schema therapy on self-efficacy, burnout, and perfectionism of employees with imposter syndrome. Health and Development Journal, 11(3), 140-148.
Chatterjee, D. (2024). Imposter Syndrome and Its Relationship with Self-Efficacy and Achievement of Success. Available at SSRN 4815409.
Crowe, T., & Slocum, S. (2022). How to stop imposter syndrome from sabotaging your career. In Women in mechanical engineering: Energy and the environment (pp. 91-107). Cham: Springer International Publishing.
Hernandez, M., & Lacerenza, C. (2023). How to help high achievers overcome imposter syndrome. MIT Sloan Management Review, 64(2), 1-5.
Grasse, K. M., Junius, N., Weatherwax, K., Sisodiya, S., Martin, A., & Carstensdottir, E. (2024). Pseudo-Scientist: Towards Narrative Interventions for Imposter Syndrome. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 8(CHI PLAY), 1-29.
Siddiqui, Z. K., Church, H. R., Jayasuriya, R., Boddice, T., & Tomlinson, J. (2024). Educational interventions for imposter phenomenon in healthcare: a scoping review. BMC Medical Education, 24(1), 43.
Tulshyan, R., & Burey, J. A. (2021). End imposter syndrome in your workplace. Harvard business review, 14, 4729.
Wilkinson, C., & Wilkinson, S. (2023). A joint autoethnographic account of two young women in academia: On overcoming imposter syndrome. Academic women: Voicing narratives of gendered experiences


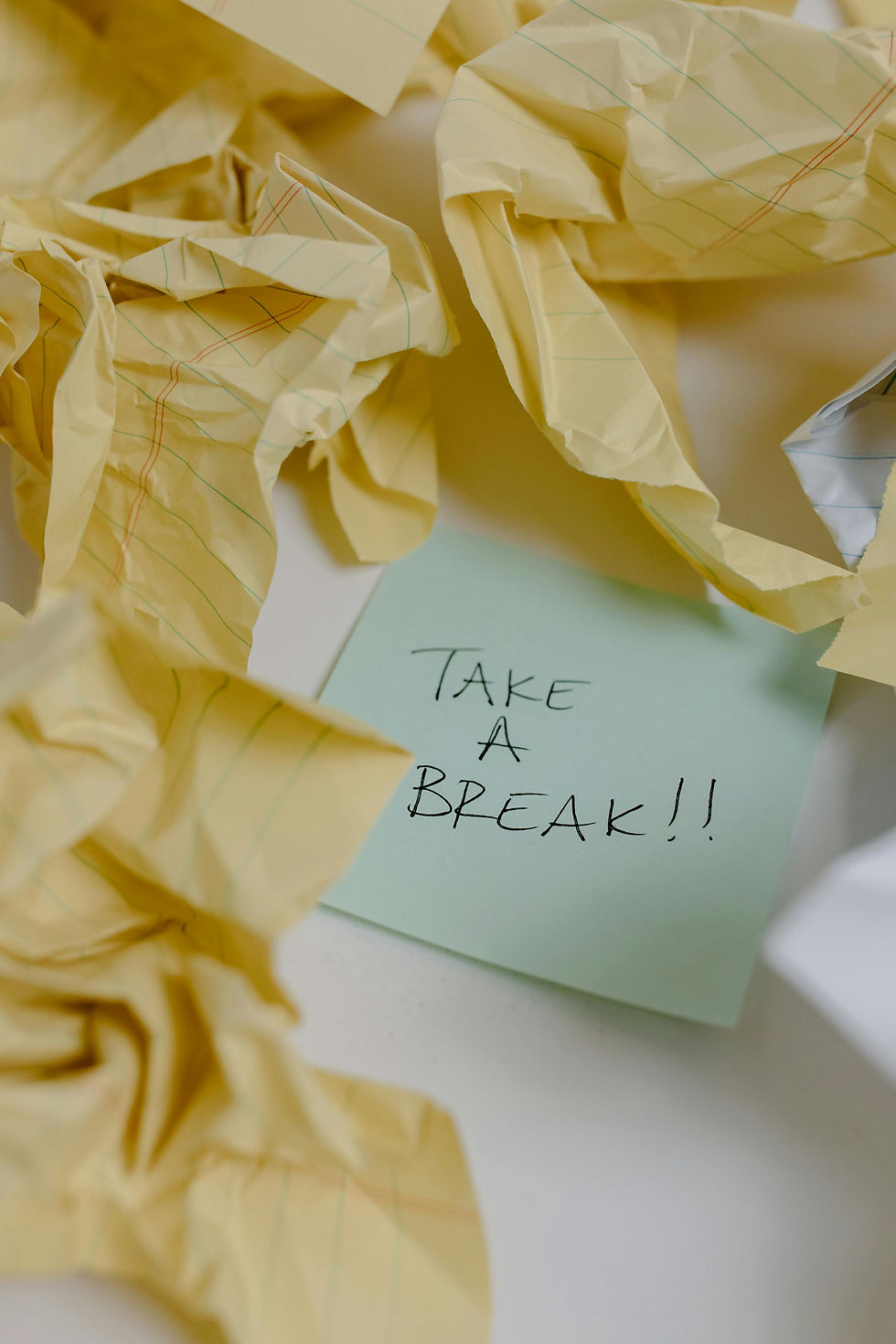
Commentaires